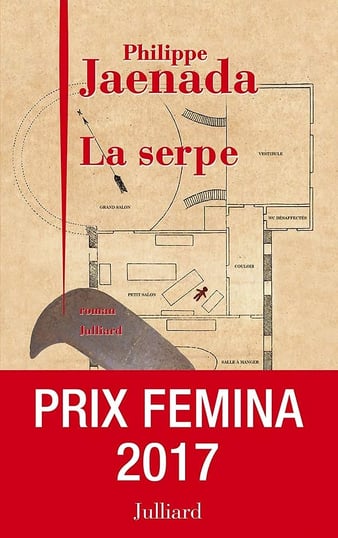Philippe Jaenada - Alice Géraud : le réel dans la peau
Pour inaugurer notre série d'entretiens croisés, dialogue entre Alice Géraud et Philippe Jaenada, le Pape du True Crime à la Française



Depuis la parution de Sulak il y a dix ans, récit en caméra embarquée sur les traces d’un glorieux braqueur, émule d’Arsène Lupin, Philippe Jaenada s’est frayé un chemin parmi les plus grands romanciers français contemporains en façonnant une oeuvre à part où investigation et mise en récit du réel sont les deux faces d’une même pièce. Sa spécialité : le fait divers. Avec un goût prononcé pour les affaires jugées à la hâte et les mauvais coupables.
Qu’il retrace sa quête obsessionnelle pour rendre justice à Pauline Dubuisson dans La Petite Femelle, qu’il tente de résoudre le mystère autour du triple crime du Château D’Escoire, dans La Serpe (Prix Femina 2017), ou qu’il perce les secrets de la psyché du tueur fou Lucien Léger dans Au Printemps des Monstres, Philippe Jaenada applique toujours la même méthode : une enquête minutieuse pour déterrer ces vieilles affaires et une gouaille sans pareille pour nous les raconter. Qui d’autre que lui pouvait être notre invité ?
Quel rapport entretenez-vous avec le fait divers ?
Alice Géraud : je me sers du fait divers justement pour en sortir. Ce qui m’intéressait dans le livre, ce n’était pas l’affaire Dino Scala en elle-même mais plutôt ses implications sociétales, politiques. Je voulais interroger la manière dont on a traité la parole des victimes d’agression sexuelle et de viol ces trente dernières années, depuis la dernière moitié des années 80, soit le premier crime commis par Dino Scala jusqu’à l’ère #metoo puisqu’il est arrêté en février 2018. Pour cela, j’avais besoin d’approcher le fait divers par un côté peut-être moins habituel, je ne voulais pas me focaliser sur la figure du criminel, du monstre mais plutôt sur les victimes, le contexte, les différentes époques et les mutations de la société.
Philippe Jaenada : Soyons bien clair, le fait divers n’a aucun intérêt en lui-même, c’est dix secondes ou une minute de barbarie, de méchanceté pure, de haine et de rage. Ce qui compte, c’est ce qu’il y a autour. Ce qui ressort de votre livre, ce sont d’abord ces pauvres filles, des victimes qu’on ignore, qu’on méprise, c’est bien plus fort que l’affaire, c’est de l’ordre de la vie.

Qu’est-ce qui fait d’un fait divers un bon sujet littéraire ?
P.J : Je ne suis pas dans la fascination pour le sang ou le crime. Ce qui m’intéresse, c’est la déflagration et les conséquences que ça peut avoir sur l’entourage. Je m’intéresse d’abord à la nature humaine, aux gens. Et l’intérêt principal des faits divers, c’est qu’ils sont extrêmement documentés. Dans le cas de l’affaire Dubuisson, ce sont des milliers d’entretiens avec des gens qui la connaissent depuis toujours, des gens qui l’ont croisée dix minutes, c’est un puzzle fou pour recomposer une personne. La figure du tueur en série n’est pas intéressante, c’est trop fou, trop monstrueux, je préfère un crime unique qui soudainement traverse plusieurs vies, les fracasse.

A.G : J’ai couvert beaucoup de faits divers à Libé. Mais là, c’était différent. Sans savoir pourquoi, je monte dans un train pour Maubeuge. C’est en discutant avec des victimes que naît l’émotion. Elles me racontent les faits comme si ça s’était déroulé la veille. Je comprends que toute leur vie a été conditionnée par ces minutes sordides au bord d’une route. Et elles ont un truc en commun, cette colère de pas avoir été entendues. Elles découvrent qu’elles sont les victimes d’un tueur en série qui vit depuis des années à côté de chez elles en toute impunité. C’est là que je décide d’en faire un livre et pas un article, parce que le livre c’est sacré, la parole n’y est jamais dévoyée. Je pouvais leur accorder la place qu’elles méritaient.
Vous avez tous les deux mis plus de quatre ans à écrire votre dernier livre, avec des enquêtes très longues, quelle méthode de travail avez-vous adoptée ?
P.J : Dans La Serpe, j’estimais avoir trouvé le coupable et les gens me prenaient pour une sorte de Colombo mais je leur disais : « non, c’est simplement que j’ai passé plusieurs années de ma vie sur le dossier. Aucun flic n’a eu le dixième de ce temps ». J’aime tellement l’enquête, je pourrais ne faire que ça, me vautrer là-dedans. Dans Au Printemps des monstres, j’étais tellement excité par l’affaire que j’en ai oublié de me focaliser sur le récit. Il faut toujours garder à l’esprit qu’on fabrique un objet littéraire et pour cela, il faut une méthode. Tout ce que je trouve dans les archives, dans la presse, sur les différents lieux de l’affaire, je le raconte dans mon dictaphone. Pour mon nouveau livre, je viens de terminer la phase d’investigation, j’ai 3900 fichiers son de chacun deux ou trois minutes. Pendant trois mois, je vais m’occuper de les coucher sur papier. Ce n’est qu’après que débutera l’écriture.
A.G : Je n’ai pas encore le recul de Philipe mais dans le cas de Dino Scala, je me lançais dans trente ans d’affaire criminelle. J’ai tout de suite su qu’il fallait que je raconte ça de manière chronologique parce que je voulais montrer que les choses s’enchaînent, se répètent et il ne se passe rien. J’ai nourri une espèce de monstre de plusieurs centaines de pages avec des récits qui se superposent, le récit des femmes, les documents policiers et judiciaires, les archives de la presse locale qui étaient étonnamment vide, j’ai fait une étude de la région, une vue d’ensemble de ses paysages. Les calques des récits se sont progressivement superposés pour ne faire qu’un.
P.J : C’est le moment que je préfère. Quand on a réuni toute la matière, qu’on a notre bloc de marbre et qu’il faut tailler. C’est là que naît la littérature.
La littérature du fait divers, c’est aussi la confrontation avec un récit médiatique ?
A.G : Le fait divers en lui-même est déjà un genre médiatique. On est dans un cadre de pensée bien spécifique avec toujours la même rengaine. Dans le cas de Dino Scala, il n’y a d’abord rien eu puis on nous a servi le refrain habituel : un homme sans histoire, un voisin sympathique, une invisibilisation des victimes. Or là, c’est justement le nœud de l’histoire, le fait de ne pas avoir cru les victimes.
P.J : J’essaye toujours de resituer le travail des journalistes dans leur époque, de ne pas être trop dur avec eux mais dans le cas de Dino Scala, j’ai du mal à comprendre un tel silence…
A.G : Pendant très longtemps, les policiers et les journalistes ne sont que des hommes, entre hommes. D’abord, il y a du sexisme, ensuite il y a une non-connaissance totale de ce qu’est la criminalité sexuelle et puis il y a l’idée que ces affaires relèvent de l’intime, qu’elles ne relèvent pas de la société. C’est un mélange d’indifférence, de tabou et de gêne.
P.J : Je pense aussi à la prise en compte de l’idée de traumatisme. Parce qu’on ne réalisait pas à l’époque. Les flics étaient plutôt du genre à dire : « c’est bon, il t’a touché les seins, ça va pas changer ta vie ».
A.G : Mon lectorat est majoritairement féminin mais j’ai quelques hommes aussi et je reçois parfois des retours genrés, des hommes qui me disent, je ne savais pas que cela faisait ça sur les vies des femmes. Comme quoi, ça sert aussi à ça les livres.

Est-ce que vous vous considérez comme des romanciers ou c’est autre chose ?
A.G : On ne va pas être d’accord sur ce point. Je viens du pays des faits, pas du pays des fées, j’ai toujours été journaliste, j’aime raconter des histoires mais je ne peux pas aujourd’hui me considérer comme romancière ou écrivaine. Pas seulement parce que je n’introduis pas de fiction dans ce que je fais, pour moi, la frontière ne se situe pas là mais par rapport à ma démarche. C’est un puzzle très compliqué à construire et si je me contente de poser tout ça sur la table, ça ne fera pas sens. Il faut que je construise du récit donc je pique simplement à mes voisins écrivains quelques procédés…
P.J : … Mais cet acte-là, cette narration du réel, c’est déjà, en soi, un acte de romancier
A.G : Peut-être… Il y a aussi sans doute une question de légitimité. Je ne veux pas me prendre pour une autre. Je ne me sens pas artiste mais artisan. Je suis également scénariste et je n’écris que de la série parce que c’est très technique, je ne me sens pas d’écrire un long métrage parce qu’on entre dans un domaine plus artistique. Je ne me permettrais pas de faire intrusion dans le livre comme vous par exemple.
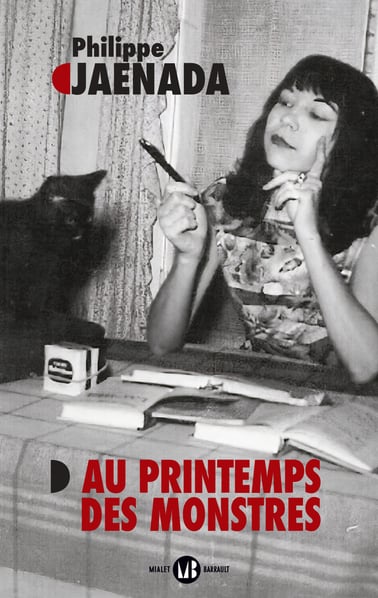
P.J : Je traite les affaires sans rien inventer, sans rien modifier, c’est un travail documentaire. Mais mon personnage, mon narrateur, en l’occurrence moi, c’est vrai qu’il y a une forme de mise en scène qui ressemble à un jeu romanesque. Peut-être que je fais ce que je raconte dans le livre, peut-être pas et on s’en fout. Ce que je ne supporte pas, c’est la triche. Paul Valéry disait : « il y a plus faux que le faux, c’est le mélange du vrai et du faux ». Et dans ce genre de la littérature du réel, il y a des auteurs qui commencent un livre à l’aide des archives et qui remplissent les blancs avec des choses inventées. Ça me dérange profondément comme démarche…
A.G : Je crois qu’on partage cette rigueur de l’investigation mais je la pousse plus loin en adoptant une approche stricte qui exige neutralité et objectivité. Je veux être irréprochable, ne pas prêter le flanc à la critique
P.J : Alors que les critiques c’est le cadet de mes soucis. On m’a reproché toute ma carrière d’avancer des théories, de prendre position mais j’écris simplement ce que je ressens après mon enquête. D’ailleurs, on comprend très vite dans votre livre que vous avez passé de longues heures à écouter les victimes, moi, j’évite à tout prix les rencontres, de me mêler aux acteurs ou aux descendants des acteurs des affaires que je raconte parce que j’ai peur que ça m’enlève toute ma subjectivité.
Qui dit littérature du réel dit implication dans la vraie vie, vous avez conscience du pouvoir de vos livre ?
P.J : J’allais vous poser la question ! J’ai vu qu’une des affaires liées à Dino Scala avait été réouverte il y a quelques semaines, est-ce que votre livre n’aurait pas joué un rôle dans tout ça ?
A.G : Certaines victimes n’existaient nulle part parce que leur plainte n’avait pas été enregistrée, d’autres étaient dans la procédure mais sans être prises en compte. Elles sont toutes dans le livre alors peut-être que ça a joué un rôle.
P.J : C’est quelque chose qui me perturbe, l’intervention des livres dans la vraie vie. C’est pour ça que je m’intéresse à de vieilles affaires. Mes livres ne changeront rien. Pauline Dubuisson a été traitée toute sa vie comme une moins que rien et maintenant elle est morte. Mon livre ne viendra pas à son secours. Vous, en revanche, j’ai vu dans votre livre une entreprise plus directe de dénonciation, un texte engagé pour que ça change.
A.G : J’ai quand même l’impression que vos livres cherchent à rétablir une vérité ! S’ils n’ont pas de conséquences directes sur les affaires, ils peuvent contribuer à changer les mentalités

Réparer l’injustice, c’est le moteur de votre écriture ?
P.J : Pour le prochain roman, j’arrête mais oui, ça m’a accompagné pendant tous mes derniers livres. Je me sentais peut-être un peu justicier. En écrivant La Petite Femelle, je voulais laver l’honneur de Pauline Dubuisson, dans La Serpe, je volais à la rescousse de George Arnaud, qu’on considérait toujours comme le coupable, trente ans après. Mais aujourd’hui, je me rends compte que c’est peut-être une mauvaise motivation… D’abord, je reçois des dizaines de lettres me proposant de venir au secours de tel ou tel accusé. Je suis complètement dépassé. Mais surtout parce qu’aujourd’hui, je trouve ça présomptueux de jouer au super-héros.

A.G : Je n’utiliserais pas le terme de justicière mais oui je voulais combattre l’injustice avec ce livre. La colère que j’ai partagée avec ces femmes en les écoutant, il fallait qu’elle rejaillisse sur le papier. C’est un geste politique, il y a quelque chose de l’ordre de l’engagement. L’époque m’a poussée, je dédie le livre à ma fille parce que je vois à quel point cette époque et cette génération-là de jeunes filles ont réveillé des choses que moi je n’avais pas tellement interrogées. C’est grâce à elles que j’ai écrit ce livre.
Que pensez-vous de cette déferlante du True Crime aujourd’hui, cette invasion de la narration du réel dans le paysage littéraire français ?
P.J : Je suis assez bluffé par cette nouvelle tendance. Mais ça conforte ce que je pense au fond de moi. C’est que la littérature dans sa forme la plus puissante se trouve là.
A.G : C’est le signe d’une société qui travaille sur elle-même. On vit une époque trouble où la littérature doit se confronter au réel. Et en même temps en librairie, c’est un rayon qui n’existe pas. Si on est connu, on finit dans la littérature blanche au milieu des grands écrivains, si comme moi, on ne l’est pas, on finit dans les documents, au milieu des récits autobiographiques de vieux policiers, souvent très poilus. Je croise les doigts pour le prochain.
Le Conseil de lecture d’Alice Géraud

“Adrienne Nicole Leblanc a écrit un livre qui s’appelle Les Enfants du Bronx qui pour moi est un modèle de narration du réel, un modèle d’enquête et d’écriture. Elle a été envoyée comme journaliste pour couvrir le procès d’un dealer et elle s’est finalement retrouvée à suivre la vie de la femme du dealer pendant douze ans ainsi que celle de tout un groupe de femmes du Bronx. On pénètre l’envers du décor des affaires de deal. C’est absolument fascinant et c’est surtout impressionnant du point de vue de l’écriture”.
...