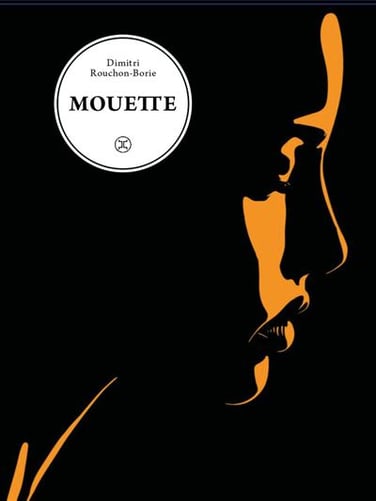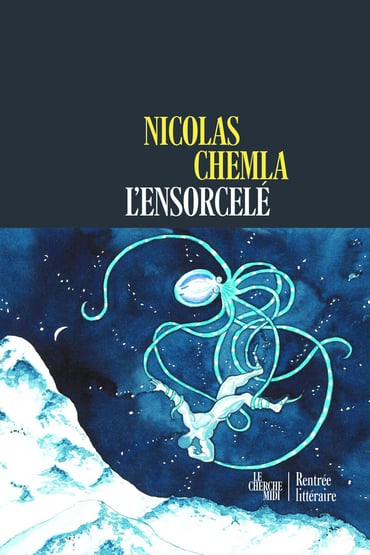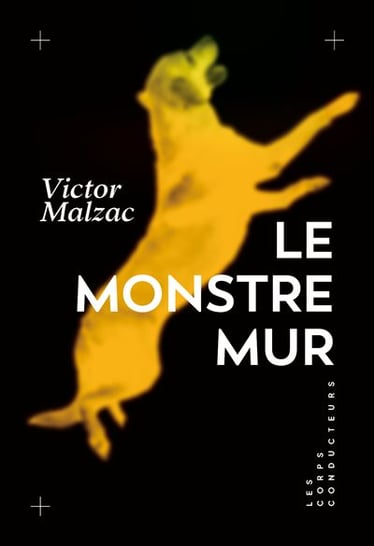Mauvais garçons pleins d'avenir
Et si on vivait un nouvel âge d’or du genre à la française ?



Tout a commencé au cinéma. Julia Ducournau avec Grave (2016) puis la palme d’or Titane (2021), La Nuée de Just Philippot (2020), Le Règne animal de Thomas Cailley (2023), plus récemment The Substance de Coralie Fargeat (2024). Autant de films jouant avec les frontières du réel, diablement inventifs et profondément dérangeants. L’avènement d’un nouveau genre à la française.
Aujourd’hui, ce sont les romanciers qui prennent la relève. Un trio d’écrivains magnétiques, maléfiques, illumine la rentrée hivernale avec des oeuvres noires qui font de la psyché humaine un lieu du roman à part entière, un territoire cauchemardesque à investir. Âmes sensibles s’abstenir.
Dimitri Rouchon-Borie, Mouette (Le Tripode)
Ancien chroniqueur judiciaire, Dimitri Rouchon-Borie est hanté par la question de l’origine de la violence. Le Démon de la colline aux loups nous avait foudroyé en déployant avec un style cru, brutal, l’ultime introspection d’un prisonnier au seuil de l’abîme. Mouette parachève avec maestria ce chœur déchirant de psychés gangrénées par le mal.
Un homme se réveille dans une grotte étroite et sombre, en partie amnésique. De haute lutte, il progresse dans les goulots de ce qu’il appelle le Boyau, comme s’il était la proie d’un organisme vivant. Jusqu’à atteindre un camp de base établi par trois compagnons de galère. Une micro-société obsédée à l’idée de trouver un chemin vers la lumière, régie par des règles, des croyances, qui va se retrouver bousculer par l’arrivée de Mouette, une femme recrachée par le boyau. Qui est-elle ? Que sait-elle de leur tombeau ? Ce roman traite-t-il vraiment de spéléo ?
Série B horrifique jubilatoire ambiance The Descent, labyrinthe aux confins de la folie piochant autant dans Vol au-dessus d’un nid de coucou que dans Shutter Island, puissante réflexion sur le pouvoir du langage comme ultime recours pour se raccrocher aux branches du réel, Mouette étouffe et tourmente, surprend et tiraille, étreint et émeut. De ces romans tentaculaires, décomplexés qui vous rappelle pourquoi vous faîtes ce métier.
Nicolas Chemla, L’Ensorcelé (Cherche-Midi)
Si son titre est un hommage à Barbey d’Aurevilly, L’Ensorcelé commence comme un roman de Bret Easton Ellis. À la différence que le yuppie New-Yorkais tendance psychopathe d’American Psycho a laissé sa place au prototype du pubard parisien en pleine crise de nerf.
Il arpente les Alpes suisses, fuyant une existence qui a complètement déraillé. Le jeune flambeur, le séducteur invétéré, accro au sexe, obsédé par son corps, n’est aujourd’hui qu’un homme vieillissant, plus dans le coup professionnellement, divorcé dans la douleur et sous la menace d’une affaire de harcèlement. Cette ascension doit lui permettre de digérer ce violent retour de Karma et faire un point sur la direction à donner à sa vie.
Mais au cours de sa marche, une porte étrange, encastrée dans la montagne. Il la franchit. Elle se referme brusquement derrière lui. Et très vite, les premières sensations étranges, les apparitions, les visions. Alors qu’il avance péniblement dans le tunnel sombre et labyrinthique, l’introspection se fait toujours plus intense. Sa responsabilité dans la faillite de son mariage, sa relation avec son père, avec sa fille féministe qui ne lui adresse plus la parole, les dangers de la cancel culture, le monde qui cède tout au digital : voilà notre antihéros à la merci d’un esprit qui turbine sans fin, englouti par une série de révélations plus noires que la nuit.
Auteur acclamé de L’Abîme, descente aux enfers sexuelle et mystique d’un Américain à Paris, Nicolas Chemla façonne une nouvelle plongée radicale dans les entrailles d’une psyché tourmentée. Quand la satire sociale corrosive rencontre le délire lynchéen où la digression s’élève au rang d’art.
Victor Malzac, Le Monstre mur (Les Corps conducteurs)
Normalien, doctorant et poète. gameur, fan de rap et de skate. Un pied dans le monde des adultes où l’exégète mène ses travaux universitaires sur les traces de Tristan Corbière (1845-1875) ou de l’écrivain belge Eugène Savitzkaya. L’autre dans celui des enfants où l’écrivain s’amuse. D’abord à distordre la langue, avec insolence, dans des recueils de poésie comme Vacance (2022) ou Lessive, qui vient tout juste de paraître. Ensuite à faire du langage l’instrument du mal obsessionnel qui sommeille en chacun de nous, au moyen de monologues terrassants comme Créatine, son premier roman, publié l’année dernière.
Victor Malzac, 28 ans, est de ces alchimistes qui parviennent à conférer aux mots un pouvoir extraordinaire : celui d’à la fois maltraiter nos corps, tourmenter nos âmes et fertiliser nos imaginaires. Confession scandée, assénée comme une vérité, proférée par un adolescent écorché vif qui a trouvé dans les discours virilistes et dans le culte du corps bodybuildé le seul moyen d’exister, Créatine avait trouvé la forme parfaite pour raconter comment nos obsessions finissent par nous dévorer.

Le Monstre mur en remet une couche et nous piège à nouveau dans les méandres d’une logorrhée erratique. Son personnage n’a pas de nom. Il est allongé sur un lit d’hôpital depuis aussi longtemps qu’il s’en souvienne avec comme seul horizon une fenêtre qui sert de catalyseur à ses fantasmes du monde extérieur. Monitoré, médicamenté, contraint dans ses mouvements, il se transforme en boule de rage et son esprit s’enfonce, cédant aux visions d’un monstre protéiforme qui vient la consoler en lui mettant dans la tête qu’il est la victime d’une machination, le cobaye d’une expérience.
À la seule force de sa plume et d’un enchainement de phrases qui donnent le tournis, Victor Malzac enferme son personnage, et nous au passage, dans un jeu de simulation terrifiant où tous les coups sont permis, où la réalité n’obéit plus à aucune règle, où la violence est reine. Avec à l’horizon, comme dans Créatine, la tragédie d’une autodestruction. Ou peut-être, au contraire, d’une ultime libération.
Bonne lecture !