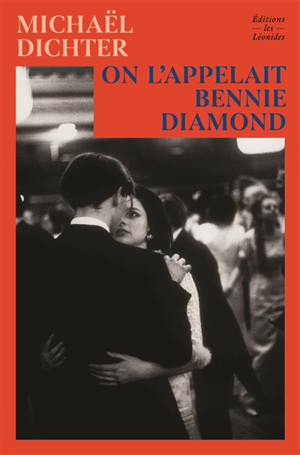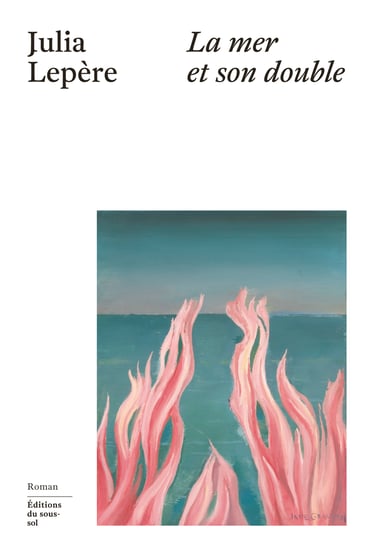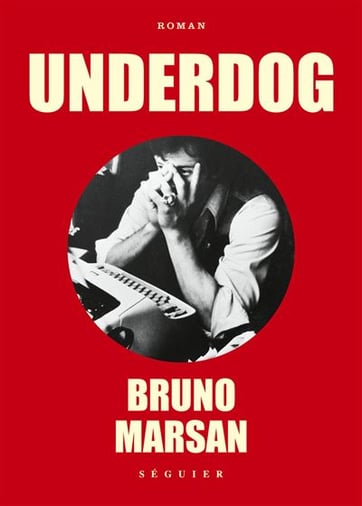Nouvelles têtes
Quatre écrivains biberonnés au cinéma et quatre premiers romans écrits comme on filme, des images plein la tête.



Michaël Dichter, On l’appelait Bennie Diamond
Confession d’un critique tout juste rescapé du tourbillon de la rentrée littéraire. À force de trop intellectualiser le roman, de vouloir en décortiquer le style ou en interpréter les discours, on en oublie parfois de souligner le pur plaisir de lecture, la joie simple de dévorer une histoire.
Avec On l’appelait Bennie Diamond, Michaël Dichter, jeune acteur et réalisateur, nous offre une précieuse piqure de rappel. Non pas que son premier roman soit dénué de poésie, bien au contraire, mais la langue qui s’y déploie se détourne des artifices et des effets de manche pour se dédier tout entière à la narration et à une plongée en immersion dans un univers secret, fantasmé et donc romanesque en diable.
Anvers et son quartier des diamantaires. Une communauté fermée, de tradition juive, régie par des règles strictes. Des pierres précieuses qu’on taille comme des artistes avant de les vendre comme des commerçants. Un monde d’argent, d’ambition et de pouvoir. Voilà où naît Bennie Goodman, un jour de 1961. Élevé dans une retoucherie, auprès d’un père qui passe le plus clair de son temps à la synagogue et rêve de voir son fils marcher dans ses pas, l’adolescent est porté par un feu intérieur d’une toute autre ampleur. Une soif de richesse et de réussite héritée de son grand-père Yéhuda, grande figure de la bourse diamantaire qui a répudié sa famille.
Ponctué de flashbacks, expliquant les drames qui ont forgé ce mystérieux patriarche, le récit raconte avec un style effréné, dans le Anvers interlope des années 70, l’irrésistible ascension, les amours et les désillusions d’un jeune loup aux dents longues. Quand le Balzac d’Illusions Perdues rencontre le Scorsese de Casino. Un pur joyau.
Julia Lepère, La mer et son double
En plus d’avoir largement contribué, en publiant David Grann ou Gay Talese, à l’émergence en France de la « narrative non-fiction », genre roi aux États-Unis mêlant journalisme et littérature, les éditions du Sous-Sol assument depuis quelques temps, avec le même talent, une autre mission : servir de tribune aux voix féminines les plus inventives, les plus troublantes aussi, de la nouvelle génération romanesque.
Après l’alchimiste Laura Vazquez, la dure à queer Phoebe Hadjimarkos Clarke et bien sûr la déflagration Adèle Yon, c’est au tour de la poète Julia Lepère de venir infuser nos imaginaires. La Mer et son double est un premier roman foisonnant, sorte de matriochka littéraire où les récits s’enchâssent, où le réel s’effrite et s’illusionne.
Western métaphysique dans une ville fantôme caniculaire, devenue le décor d’un film impossible à tourner, voyage paranormal sur un cargo du bout du monde où se multiplient les disparitions et les apparitions mystérieuses, conte fantastique empruntant au folklore Inuit, quête intime d’une femme cherchant à appréhender son histoire et dompter ses traumas : perdez-vous sans crainte dans ce labyrinthe où rôdent aussi bien les fantômes du Paris Texas de Wim Wenders que du Terreur de Dan Simmons.
Bruno Marsan, Underdog
Underdog, pour les non-initiés aux sports de combats, l’outsider, celui qu’on n’attend pas mais qui s’apprête à vous mettre un joli crochet du droit. Un titre prémonitoire pour un auteur qui a attendu 60 ans avant d’écrire son premier roman, dont le récit décomplexé, rafraîchissant est devenu, un peu par surprise, le tube de l’hiver.
Bruno Marsan façonne, dans les années 70, un double récit d’initiation qui déroule en parallèle, l’improbable ascension de Richard Moreira, un loser magnifique, double à peine dissimulé de l’auteur, qui va fuir son Béarn natal et s’envoler pour l’Amérique destination la richesse et la gloire, et les années de dèche de son modèle, son maître à penser, l’acteur et réalisateur Sylvester Stallone, un SDF de 29 ans, en pleine écriture d’une histoire de boxe, qui s’apprête, sans le savoir, à entrer dans l’Histoire.
Une quête intime et poétique, sans mythologie facile ni héroïsation mélo, sur les chemins de la fragilité et des rêves bafoués, sur la persévérance et le succès qu’on aurait jamais osé espéré. Le tout baigné de cinéma et verni d’une couche de satire pop. Avec Underdog, Bruno Marsan invente le blockbuster d’autofiction.
Jean-Philippe Daguerre, La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob
Aux origines du premier roman de Jean-Philippe Daguerre, dramaturge à succès récompensé de neuf Molières, une folle histoire vraie, quasi oubliée. 18 octobre 1973, en pleine guerre du Kippour, une jeune femme détourne un vol Paris-Nice avec des revendications pour le moins étonnante : la saisie de toutes les bobines du film de Gérard Oury, Rabbi Jacob, qui sort le jour même dans toutes les salles de l’Hexagone et la promesse que le gouvernement français n’autorisera sa diffusion qu’une fois la paix instaurée entre les pays Arabes et l’Israël.
La forcenée n’est autre que Danielle Cravenne, femme de Georges Cravenne, pionnier français des relations publiques, attaché de presse des grandes figures du cinéma français mais aussi des grandes sorties internationales comme Le Parrain et surtout un proche de Gérard Oury et de Louis de Funès, chargé de la promotion de Rabbi Jacob.
En se glissant malicieusement, avec un style très théâtral, effréné, parfois même un peu trop vaudeville, dans la peau de chacun des personnages illustres qui a vécu de près ou de loin cette histoire, Jean-Philippe Daguerre raconte les dessous d’une affaire qui prête d’abord à sourire avant de faire froid dans le dos. Car l’histoire de Danielle Cravenne est celle d’une femme qui au nom d’un engagement, d’une utopie a subitement sombré dans la folie. C’est celle aussi d’un gouvernement français qui en pleine tension sociale et religieuse n’a pas fait dans la dentelle pour éliminer un problème gênant. Sans jamais répondre aux accusations de crime d’Etat.
Bonne lecture
Pour se procurer les livres :
Michaël Dichter, On l’appelait Bennie Diamond (Les Léonides)
Julia Lepère, La mer et son double (Sous-Sol)
Bruno Marsan, Underdog (Séguier)
Jean-Philippe Daguerre, La Femme qui n’aimait pas Rabbi Jacob (Albin Michel)