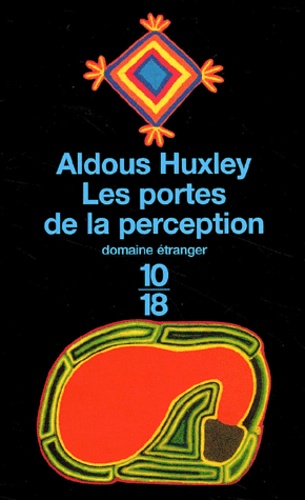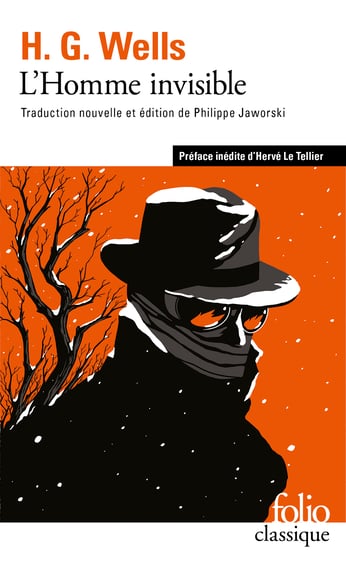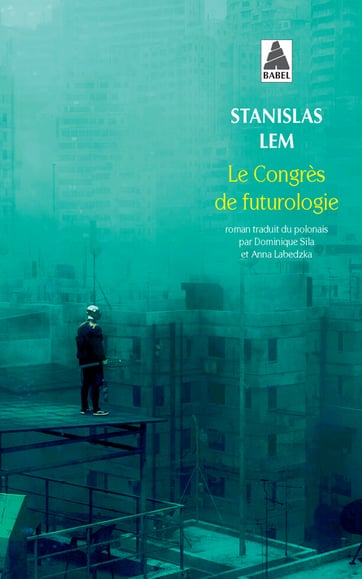Very Bad Trip
Drogue et science-fiction : bad trip assuré


INCIPIT
5 min ⋅ 11/02/2025

« Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie » Les vers du poète mystique William Blake dans Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (1793), que le pape de la SF Aldous Huxley empruntera cent-cinquante ans plus tard pour écrire ce qui est encore considéré aujourd’hui comme un des plus grands ouvrages psychédéliques, illustrent à merveille la fascination séculaire des écrivains pour ces substances qui les plongent dans un état de sidération, qui provoquent chez eux une révélation soudaine altérant leur rapport au monde. Cette transe les intéresse par essence parce qu’elle ouvre les champs du possible de la création. Elle vous fait accéder à d’autres dimensions mais elle permet surtout de plonger, plus loin que vous n’avez jamais été, dans votre for intérieur.
De Baudelaire et son club des Hachichins à Burroughs et la Beat Generation, la littérature moderne est marquée par le sceau de ces expériences visant à repousser toujours plus loin les limites de la langue. Mais pour la science-fiction, genre de sale gosse qui cherche toujours à appuyer là où ça fait mal, la drogue représente bien plus qu’un simple procédé d’écriture. Elle est un sujet de prédilection qui peuple ses histoires. Car raconter ce que l’Homme est prêt à faire pour se réfugier dans les paradis artificiels, c’est se confronter aux raisons qui le poussent à fuir la réalité.
À quoi ressembleront nos dépendances de demain ? Quel rôle la science jouera-t-elle dans la création de nouvelles substances toujours plus addictives ? Notre rapport au réel peut-il s’en trouver totalement bouleversé ? En marchant sur une ligne de crête, entre une drogue conçue comme une libération, une émancipation de la morale et de la raison et une drogue symbolisant une aliénation tragique des corps et des esprits, la SF n’a cessé de vouloir de répondre à ces questions. Parez pour une défonce littéraire ?
Voyage au pays des merveilles
La drogue, c’est d’abord la promesse d’une aventure au-delà du réel, dans d’autres mondes et d’autres dimensions. Prenez Alice au Pays des Merveilles (1865), œuvre pionnière des littératures de l’imaginaire. Bourré d’allusions perverses, le roman a des airs d’invitation au voyage psychédélique. L’histoire de cette jeune fille qui tombe littéralement dans le terrier d’un lapin pour y découvrir un nouveau monde fait de gâteaux magiques et de champignons hallucinogènes laisse peu de place aux doutes même si l’image de drogué de Lewis Caroll doit beaucoup à la chanson de Jefferson Airplane, White Rabbit.
À partir de ce trip fondateur, toute une série de récits SF a conçu la drogue comme un passeport vers l’ailleurs. Parmi les plus marquants, L’Arbre à rêve de James Morrow (1984). Dans une galaxie lointaine, les populations se délectent de frêves, des pommes hallucinogènes qui vous font vivre de folles expériences dans des univers variés. Les frêves sont même un art et Quinjin, le héros, en est l’un des critiques les plus réputés. Mais un jour, un fruit apparaît sur le marché et répand la terreur chez ceux qui l’ont consommé.
On retrouve ici une constante du trip science-fictionnel, son côté schizophrénique, entre jouissance et souffrance. Une dichotomie sur laquelle Jeff Noon appuie sans pitié avec Vurt, objet littéraire non-identifié couronné du prestigieux prix Arthur C. Clarke en 1994. Dans un Manchester futuriste ravagé, Scribouille et ses Chevaliers du Speed se gavent de la meilleure des drogues du marché, des plumes colorées qui donnent accès à un univers parallèle terrifiant dans lequel ils ont perdu l’une des leurs. Cette quête destroy et effrénée, à cheval entre les réalités, rappelle que dans la SF, voyage psyché égal danger.
Le Vertige Cyberpunk
Un sous-genre a fait de cette dialectique de la drogue et de l’ailleurs, un motif romanesque autrement plus complexe et foisonnant en y ajoutant une dimension technologique : le cyberpunk. Ce dernier imagine des univers sombres dans lesquels la cybernétique est devenue monnaie courante et où l’accès à un monde parallèle, le cyberspace, apparaît comme la seule échappatoire à un réel insupportable. Addiction chimique et virtuelle s’entremêlent. Si la drogue permet de s’enfuir dans les réseaux, ce sont surtout les réseaux eux-mêmes qui deviennent une drogue.
Prenez Case, le héros de Neuromancien (1984), l’œuvre pionnière du genre signée William Gibson. Quand débute l’histoire, il n’est qu’un junkie qui tente d’oublier grâce à la défonce son bannissement du Cyberspace. Mais dès qu’une occasion inespérée lui est offerte de retourner dans ce monde virtuel où ses talents excellent, le hacker replonge dans une autre forme de dépendance : se brancher pour exister.
La confusion entre les réalités et les addictions est également à la base du Samouraï virtuel de Neal Stephenson (1992), monument cyberpunk. Dans une société qui partage son temps entre un monde où tout n’est que survie et un metavers plus épanouissant mais aussi plus dangereux, une drogue, le Snow Crash, sème le chaos parce qu’elle a le pouvoir d’affecter les deux univers en parallèle. Hiro Protagoniste, livreur de pizza pour la mafia le jour, hacker réputé et champion de sabre la nuit, devient le héros malgré lui d’une bataille entre réel et virtuel. Et cette phrase du roman de résonner longtemps : « Ce Snow Crash, au juste, c'est un virus, une drogue ou une religion ? »
La Fabrique du surhomme
Si la dope, ces étranges potions, sont partout dans la science-fiction, c’est parce qu’elles posent une autre question, celle de la performance et de la fabrique du surhomme, grande obsession des écrivains du genre. Déjà, dans L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886), écrit selon la légende lors d’une session cocaïne de six jours, Robert Louis Stevenson invente un sérum que s’injecte le docteur Jekyll afin de transformer son corps et de le libérer de toute inhibition. Pour le meilleur mais surtout pour le pire.
C’est aussi une drogue qui rend L’Homme Invisible (1897) chez H.G Wells, grand maître de l’imaginaire qui, quelques années plus tard, publiera Le Nouvel Accélérateur (1901), roman méconnu mais génial dans lequel un savant fou fabrique une substance capable de décupler ses capacités cognitives et de ralentir le monde qui l’entoure.
Une histoire qui rappelle d’ailleurs un ouvrage plus récent, The Dark Fields d’Alan Glynn, rendu célèbre par Limitless, son adaptation, dans lequel le NZT permet à celui qui l’a ingéré d’utiliser toute l’étendue des pouvoirs du cerveau humain. Dans la saga Dune, publié en plein Flower Power, Franck Herbert va même plus loin puisque les pouvoirs d’immortalité et de préscience que procurent l’épice, substance récoltée sur la planète Arrakis deviennent l’enjeu d’une guerre galactique impitoyable. Autant d’œuvres à l’issue dramatique pour une même conclusion : la drogue n’est pas un don mais une malédiction.
Aliénation fatale
« La réalité ne peut être passée sous silence, sauf moyennant un prix à payer ; et plus on persiste à la passer sous silence, plus le prix à payer devient élevé » Voilà comment Aldous Huxley, encore lui, résume dans Les Portes de la perception, le paradoxe tragique qui entoure le psychédélisme. En contrepoint de cet ailleurs tant désiré, de cette toute puissance qui nous obsède se dresse l’aliénation fatale des corps et des esprits. Dans la SF, les histoires de drogues finissent mal.
Pour l’individu d’abord, pris au piège d’un processus d’autodestruction raconté de manière sidérante par Philip K. Dick, dans Substance mort (1977). Dissimulé sous un « complet brouillé », un long manteau technologique qui permet aux personnes de masquer leur identité, Fred travaille incognito pour la brigade des stups. Un jour, il est chargé de surveiller un camé notoire appelé Bob Arctor. Seul hic, Bob Arctor, c’est lui. À force de se défoncer à la Substance M, la drogue qui ravage ce monde futuriste et qui a pour effet de dissocier les deux hémisphères du cerveau, sa personnalité s’est dédoublée sans que l’une prenne conscience de l’autre. Inspiré par la cohorte de camés qui a toujours entouré l’auteur, le roman dévoile l’enfer des paradis artificiels.
Mais pour la société surtout lorsque maîtres de la SF font de la drogue l’arme de prédilection des pouvoirs autoritaires pour contrôler les foules. Dans la nouvelle Une fantaisie du docteur Ox (1874), Jules Verne imaginait déjà les manigances d’un savant fou qui grâce à un gaz psychédélique, transformait les habitants d’un hameau paisible en brutes avides de sang. Tout le contraire du Soma, la drogue de synthèse distribuée aux citoyens du Meilleur des Mondes, d’Aldous Huxley (1932) dans le but de les rendre docile. Quelques années plus tard, dans Kallocaïne (1940), Karin Boye pousse le curseur encore plus loin et raconte les conséquences dystopiques de l’invention d’une drogue aux allures de serum de vérité qui met fin à toute liberté de penser et de rêver.
Vous tremblez ? Stanislas Lem est là pour vous achever. Son inoubliable Congrès de futurologie raconte comment un gouvernement adepte de psychimie maintient sa population dans une hallucination éveillée pour qu’elle ne se rende pas compte que tout autour d’elle s’est effondrée. Sommes-nous drogué pour être contrôlé ? Et si ce que nous percevions n’était pas la réalité ? Oula, on a peut-être un peu forcé. Drogue et science-fiction, le bad trip assuré.
...