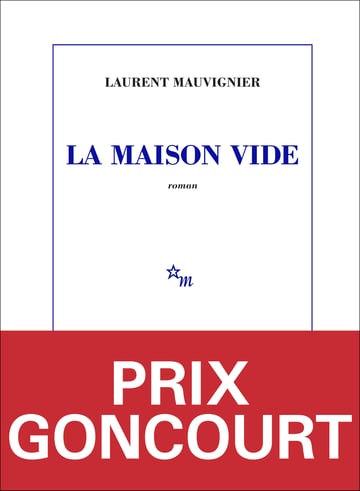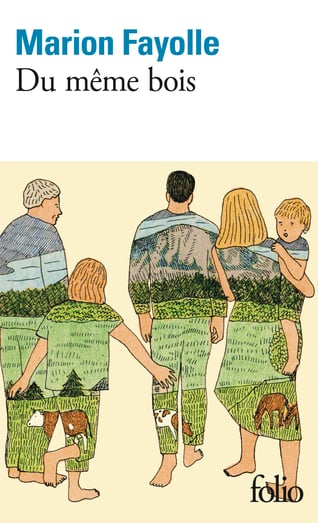Une partie de campagne
En plus d'être une grande romancière et une styliste hors pair, Marie-Hélène Lafon est celle qui parle le mieux d'écriture. Rencontre au pays de la langue et de la littérature.



Née à Aurillac, Marie-Hélène Lafon a fait du Cantal le décor d’une grande partie de son œuvre. Un monde rural, au cœur de récits où la fatalité dispute à la poésie. En pleine crise agricole, elle façonne, dans Hors Champ, une fresque romanesque qui traverse 50 ans de la vie d’une famille paysanne avec comme ligne de fuite, les deux existences, en miroir, d’un frère, qui est restée et d’une sœur, qui est partie. Sublime et bouleversant.
Quel a été le point de départ de l’écriture de votre roman ?
Je n'en avais pas terminé avec Gilles, un des protagonistes des Sources (2023). J’avais besoin de continuer à creuser sa vie en façonnant une histoire alternative. Ici, la matière première, c’est le lien qu’il entretient avec sa sœur, Claire, celle qui contrairement à lui, est partie, loin du monde rural, loin du monde paysan. Et en surplomb, une question : que reste-t-il du terreau commun de nos enfances ?
Doit-on voir dans le personnage de Claire une évocation de votre propre histoire ?
J’aime bien citer la phrase de Fellini lors de la sortie de son film Huit et Demi (1963) : « Je suis toujours autobiographique même si je me mets à raconter la vie d’un poisson ». Depuis Les Pays (2012), un jeu de miroir évident s’est installé avec Claire car elle me permet d’éviter d’utiliser le « je » sans basculer dans une autofiction frontale. Je suis en pièces détachées dans mes textes, je me cache derrière chacun de mes personnages. Etymologiquement, le mot texte nous ramène au tissage. En tant que romancière, je ne cesse d’entremêler fiction et réalité. Comment ? Secret de création.
La figure du transfuge de classe est devenue omniprésente dans la littérature contemporaine. En quoi est-elle encore plus complexe dans le monde paysan ?
Il y a ce que j'appelle des circonstances exténuantes. La séparation des vies est bien plus violente parce que le mode de vie paysan est par définition très enraciné. Gilles est isolé, il se tue à la tâche, il n’a pas fait maison, alors il s’enfonce. Claire, elle, se retrouve coincée entre deux identités qu’elle ne parvient pas à réconcilier, étrangère du milieu où elle est née, elle devient la parisienne qui s’achète une maison à la campagne. Et en même temps, elle est peut-être la dernière à percevoir la beauté de ce qui l’entoure.
Gilles, c’est Sisyphe ?
Oui, c’est une bonne comparaison. À mesure que le roman avance, la tâche devient de plus en plus écrasante. Gilles s’acharne uniquement pour recommencer le lendemain. Avec un paradoxe, il prend de plus en plus de place dans le récit et en même temps il n’est plus qu’une ombre travaillante. Claire s’installe progressivement en lisière de la vie de son frère, elle veille sur lui, essaye de stopper l’engrenage, avec cette phrase qu’elle ne cesse de lui répéter : « si tu veux arrêter tout ça, tu peux compter sur moi ». Mais il a peur de dire stop parce qu’il n’est pas adapté au monde tel qu’il va. Faut-il être adapté au monde d’aujourd’hui ? C’est une autre question.

Votre roman paraît au moment où la gronde paysanne se fait entendre, comment vivez-vous cette collision avec l’actualité ?
Je la vis avec émotion. Je ne suis ni une spécialiste, ni une porte-parole. Je suis très impliquée émotionnellement, familialement, personnellement. Mes parents et mon frère étaient paysans comme toutes les générations qui les ont précédés. Moi, j’essaye de faire ce qui est en mon pouvoir, c’est-à-dire m’emparer, grâce à l’écriture, d’une matière douloureuse, complexe.
Vous savez mieux que moi à quel point l'air du temps et le rythme médiatique s'accommodent mal de ce qui est complexe. Vous savez à quel point ils s'accommodent mal de ce qui est douloureux. Hors de question de tomber dans le pathos, chaque mot doit être pesé, lourd de sens.
D’où cet art de l’épure qui vous caractérise ?
Nous sommes dans le déversoir, assaillis de verbiage, de bavardage, où l’on ne distingue plus le vrai du faux, où le réel subit toutes sortes d'avatars. Je suis du côté d'un usage plus serré, plus rigoureux, plus exigeant de la langue. Ma vérité se trouve dans une écriture à l’os. Mais on peut tout à fait faire autrement. Prenez Laurent Mauvignier, nos histoires ont beaucoup en commun mais les siennes font 500 pages et il n'y a pas un mot de trop.
De la même manière Hors-Champ bannit les dialogues parce que dans les familles paysannes, la parole ne circule pas, les sentiments ne peuvent s’exprimer, les relations s’enlisent dans un silence pesant. Jusqu’à ce chapitre final où les mots jaillissent enfin, parce que ça devient indispensable pour rester vivant.
Au silence vous opposez des images et des sensations ?
Le hasard de la naissance m'a placé à cet endroit-là du monde et je conserverais à vie une expérience constamment ravivée de la ruralité. Des images, des odeurs, un contact avec la nature, une âpreté aussi. Mon écriture est ballotée dans ce maelström de sensations avec une perméabilité certaine à l’émotion mais encore une fois sans pathos, sans jugement, sans démonstration.
Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération de romanciers et surtout de romancières qui s’emparent de la ruralité ?
Aujourd’hui, de nombreuses femmes font littérature avec ce milieu. On a d’ailleurs beaucoup de choses en commun. Elles creusent plus loin encore des questions qui me passionnent. Le rapport au corps, le lien au vivant, le retour à la terre, l’héritage refusé. Je pense bien sûr à Camille Bordenet dont j’ai lu le roman Sous leur pas, les années à La Grande Librairie. Je pense aussi à Marion Fayolle bien sûr dont j’ai adoré le premier roman, Du même bois.
Vous avez pris à la fin de l’année dernière votre retraite de l’éducation nationale, comment avez-vous vécu ce bouleversement ?
C’est un soulagement parce que ça rentrait en tension avec mon agenda d’écriture. Mais c’est surtout un déchirement. Ça m’a couté émotionnellement. J'ai inventé ma vie grâce à l'école. Je dois tout à l'école. J’y suis rentrée à 6 ans et j'en suis sortie à 63.
Et bien sûr, il y a les élèves. J’ai vécu des grands moments de solitude, j’ai pu être en colère d’autant que j'ai toujours eu un rapport assez vertical à l'autorité. Mais jusqu’au bout, j’ai eu la sensation d’être tangible, d’avoir un beau métier, utile, nécessaire, indispensable. Je n'ai jamais vendu des produits inutiles à des gens qui n'en avaient pas besoin. Je suis fière de travailler avec la littérature. Et heureusement avec mes livres, je continue à avoir la main dans cette matière-là. La langue, c’est le pays que j’habite.